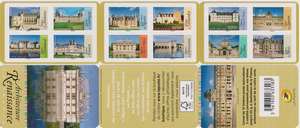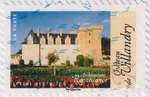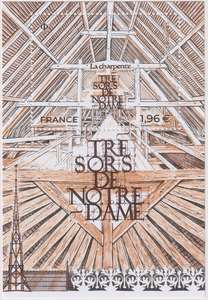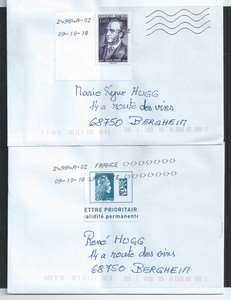Blog - Tous les billets
20-06-2024 Emission d'un collector sur les paysages de Corse
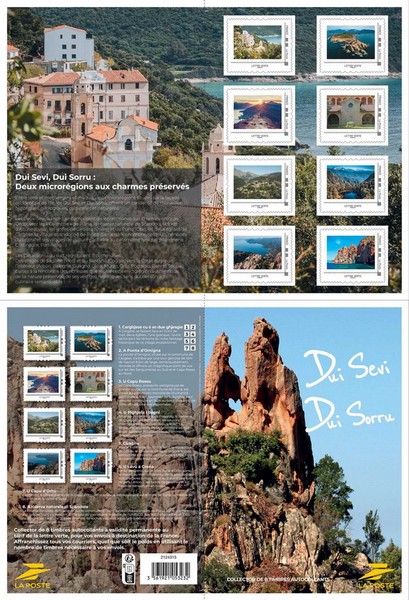
Si ce message ne s'affiche pas correctement, consulter notre version en ligne en utilisant le lien suivant :
https://www.apne.info/newsletter.php?lng=fr&pg=17072&nlpseudo=Hugg&nlgrp=all_subscribers
Pour vous désinscrire de cette lettre d'information, veuillez suivre ce lien :
https://www.apne.info/newsletter.php?lng=fr&action=unsub&nlsecure=on&nlpseudo=Hugg&nlmail=rene.hugg@wanadoo.fr
|
Cet email a été envoyé à rene.hugg@wanadoo.fr, cliquez ici pour vous désabonner.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Philantologie 2024 © Tous droits réservés.
Vous ne souhaitez plus recevoir nos emails ? Se désinscrire
|
Timbres - 2€ Commémoratives - Billets - Matériels pour Collectionneurs |
Tarifs au 01 janvier 2015
1 échelon jusqu'à 20 grs : lettre prioritaire = 0.76 - lettre verte = 0.68 lettre écopli = 0.66
2 échelon de 21 à 50 grs : lettre prioritaire = 1.25 lettre verte = 1.15 lettre écopli = 1.05
3 échelon de 51 à 100 grs : lettre prioritaire = 1.90 lettre verte = 1.75 lettre écopli = 1.45
4 échelon de 101 à 250 grs : lettre prioritaire = 3.05 lettre verte = 2.75 lettre écopli = 2.50
03 mars
Carnet les chèvres de nos régions
Carnet indivisible de 12 timbres lettre verte
30 mars
Carnet Architecture Renaissance
Carnet indivisible de 12 timbres lettre verte
Visuels Hugg - Wikitimbres.fr
France
1 échelon jusqu'à 20 grs :1.29
2 échelon de 21 à 100 grs :2.58
3 échelon de 101 à 250 grs :4.30
Etranger
1 échelon jusqu'à 20 grs : 1.96
2 échelon de 21 à 100 grs : 4.15
3 échelon de 101 à 250 grs : 9.8
2 Trimestre 2024
02/04/2024
Agnès Varda - timbre à 1.29 € lettre verte
photographe - plasticienne - réalisatrice née le 30-05-1928 - décédée 29-03-2019
05/04/2024
Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 - timbre à 1.96 € lettre internationale
08/04/2024
Salon philatélique de printemps à Salon de Provence
timbre à 1.29 € lettre verte
15/04/2024
Bloc 500 ans de la ville de New York timbre à 1.96 € monde
Bloc de la charpente de Notre Dame de Paris
timbre à 1.96 € monde
22/04/2024
Bloc Le palais idéal du facteur Cheval
timbres à 1.29 € lettre verte
timbre à 2.58 € lettre 2 échelon France
22/05/2024
timbre à 1.29 € lettre verte
30/05/2024
- bloc indivisible de 3 timbres à 1.96 € tarif international
timbre à 1.29 € lettre verte
timbre à 1.29 € lettre verte
05/06/2024
Carnet indivisible de 12 timbres à 1.29 € lettre verte
19/06/2024
- timbre à 1.29 € lettre verte
26/06/2024
timbre à 1.29 € lettre verte
- timbre à 1.29 € lettre verte
images wikitimbre - Le Carré d'Encre- Hugg
Bonjour à tous
Denis BOUDOT
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|
1er Jour du timbre « Kaysersberg, le village préféré des Français 2017 »
Le mercredi 20 juin à Kaysersberg sera mis en vente la carte postale avec le timbre du village préféré des Français de 2017 et le cachet 1er Jour. La Société Philatélique de Colmar a édité une carte postale représentant le pont fortifié. Elle sera en vente à 3 euro, place de la mairie, toute la journée du mercredi 20 juin.
Malheureusement, le visuel du timbre est resté secret, même pour nous qui avons choisi le motif de la carte postale. Le timbre sera présenté au public mardi le 19 juin, au cours d’une émission télévisuelle de FRANCE 2 à 20h50. L’émission sera réalisée sur le pont fortifié de Kaysersberg.
Pont fortifié - 1514
Rectifié par Marcel le 26/01/2019 # 13:32